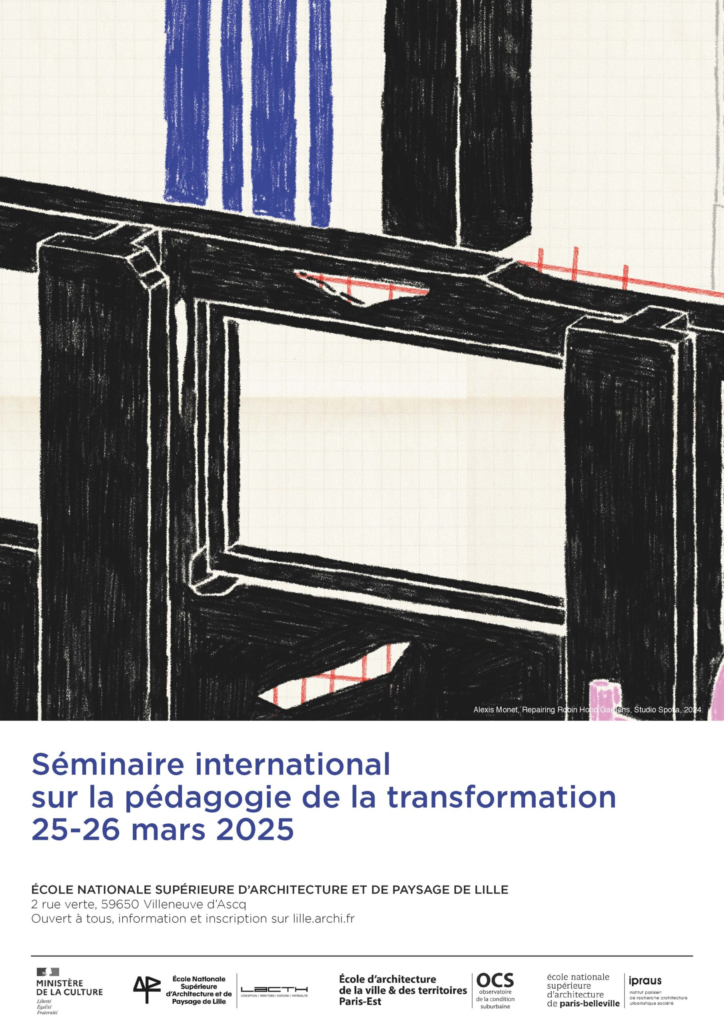
Séminaire international sur la pédagogie de la transformation
Organisation
Luc Baboulet, ENSA Paris-Est
Mathieu Berteloot, ENSAP Lille
Françoise Fromonot, ENSA Paris-Belleville
Beatrice Julien, ENSA Paris-Belleville
Paul Landauer, ENSA Paris-Est
Véronique Patteeuw, ENSAP Lille
ARCHITECTURE ET TRANSFORMATION
Réseau Scientifique et Pédagogique en Architecture
Comité de pilotage
Luc Baboulet (ENSA Paris-Est)
Françoise Fromonot (ENSA Paris-Belleville)
Aurélie Husson (ENSA Nancy)
François-Frédéric Müller (ENSA Strasbourg)
Paul Landauer (ENSA Paris-Est)
Jérôme Villemard (ENSA Strasbourg)
Informations pratiques :
– Lieu : ENSAPL
– Adresse : 02 rue Verte, 59650 Villeneuve d’Ascq
– Inscription gratuite et obligatoire
POUR UNE PÉDAGOGIE DE LA TRANSFORMATION
L’école a commencé avec un homme sous un arbre ; il ignorait qu’il était un professeur, discutant ses idées avec des gens qui ignoraient qu’ils étaient des élèves.
Louis I. Kahn
Tout design vise un but. Seules nos questions changent. Nous ne demandons plus « à quoi ça ressemble ? » ou « comment ça marche ? », mais « quel est le lien ? » (how does it relate?).
Victor Papanek
La puissance exponentielle de la civilisation industrielle depuis deux siècles nous a menés jusqu’au point où la plupart des processus qui maintenaient un équilibre relatif au sein du système Terre ont cessé de fonctionner. Si bien qu’un nouveau principe est en train d’émerger dans tous les domaines, qui demande aux arts, aux sciences et aux techniques de « réparer le monde[1] » plutôt que d’en (éco)reconstruire un autre : comme le soulignait déjà le rapport Meadows en son temps[2], il s’agit moins d’augmenter la production, désormais, que de se ressaisir de ce qui est déjà produit.
Compte tenu de leur forte implication dans cet état de fait, la discipline et les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage sont concernés au premier chef. Au-delà d’une simple adaptation à la doxa de la « transition », une telle perspective exige de leur part un profond aggiornamento : une remise en question des habitudes et des pratiques, ainsi que des notions qui les sous-tendent (parmi celles-ci : le patrimoine, l’auteur, l’œuvre, le projet, l’histoire, les relations de l’architecture et du temps…) ; un élargissement du canon de référence, puisque l’urgence écologique et l’inégale responsabilité des pays à cet égard exigent à la fois son décentrement (vision non européocentrée) et le ré-encastrement de l’architecture dans l’ensemble du monde physique et vivant (vision non anthropocentrée) dont l’histoire récente – l’industrie du bâtiment au premier chef – a profondément modifié le cours ; enfin, une évaluation critique des appareils institutionnels (administratifs, politiques, financiers, professionnels…) qui conditionnent la nature et le fonctionnement du modèle actuel – et cela afin d’agir, pour le faire évoluer, au niveau des institutions qui en assurent la transmission.
[1] Tel est le titre d’un intéressant ouvrage qui met en évidence cette évolution dans le champ de la littérature. Voir Alexandre Gefen, Réparer le monde, Paris, José Corti, 2017.
[2] Dennis Meadows, Donnella Meadows, Jorgen Randers, Les limites à la croissance (dans un monde fini), Éd. Rue de l’échiquier, Paris, réédition 2022 (1972)
PÉDAGOGIE DE LA TRANSFORMATION / TRANSFORMER LA PÉDAGOGIE
Il nous semble en effet qu’une culture de la transformation ne se développera que si l’on parvient à forger les outils pédagogiques correspondants : telle est la vocation de Trans/Form, réseau international ouvert rassemblant des initiatives européennes (masters) spécifiquement dédiées à la pédagogie de la transformation. Il a pour objectif d’être un lieu d’échange et d’élaboration active du changement, capable à sa modeste échelle de contribuer à l’évolution de ce puissant système d’activité qu’est l’architecture au sens large. Il s’efforce de développer la prise de conscience critique des enjeux actuels, l’élaboration progressive de réflexions et de pratiques alternatives et le développement d’outils concrets (théoriques, méthodologiques, techniques et culturels) propres à favoriser l’émergence et la formation d’une nouvelle génération d’ingénieux transformateurs.
LES SÉMINAIRES
Les rencontres du réseau sont conçues comme des séances de travail réunissant les membres de Trans/Form et des invités choisis pour leur capacité à éclairer tel aspect (pratique, théorique, historique) du thème considéré, en insistant sur ses implications en termes de pédagogie.
Elles se déroulent comme suit :
1/ Une introduction générale par les organisateurs des journées ;
2/ Trois sessions d’une demi-journée consacrées à trois thématiques réuniront des interventions de natures diverses : approches pratiques, réflexions historico-théoriques, propositions pédagogiques
3/ Une conférence plénière (keynote) ;
4/ Une demi-journée de travail collectif, durant laquelle les participants de chaque session se réuniront sous la conduite d’un couple d’animateurs chargés de préparer, de thématiser et de cadrer les discussions.
Un ingénieur de recherche attaché au projet, se chargera ensuite de synthétiser l’ensemble des résultats, afin de préparer la rédaction d’un ouvrage collectif à paraître en 2027.
LES THÈMES
Après une première rencontre en décembre 2023 (ENSA Paris-Est) qui a permis une prise de contact et une présentation, par chacun des masters invités, de son approche particulière de la transformation (ses postulats pratiques et théoriques, ses thèmes, ses objets, ses méthodes d’enseignement), nous proposons d’organiser les deux rencontres à venir autour des notions de ressources et d’échelles, notions certes anciennes et centrales pour l’architecture et son histoire, mais dont la nécessité d’une redirection écologique imposent de réinterroger le sens et l’usage :
– dans une perspective transformatrice, en effet, le monde n’est plus un gisement de ressources indéfiniment exploitables. C’est l’ensemble de notre patrimoine, entendu dans son sens étymologique : tout ce dont il nous faut assumer l’héritage pour le meilleur et pour le pire, afin de le projeter dans un futur dont il nous faut assumer la responsabilité.
– quant aux échelles, on mesure aujourd’hui les conséquences de leur illimitation qui, comme Ivan Illich l’avait bien vu, conduit toute « activité outillée » à franchir des seuils critiques souvent irréversibles[3]. Il nous revient donc de repérer précisément ces seuils dans les différents secteurs de cette « activité outillée » qu’est l’architecture.
Certes difficilement dissociables en pratique – la réflexion sur l’une entraînera fréquemment l’évocation de l’autre – ces deux notions nous semblent néanmoins susceptibles d’être interrogées séparément : la première réunion, qui aura lieu à l’ENSAP de Lille les 25 et 26 mars 2025, portera sur la notion de ressources ; la seconde aura lieu à l’ENSA de Paris-Belleville au printemps 2026, et portera sur la notion d’échelles.
[3] « Lorsqu’une activité outillée dépasse un certain seuil défini par l’échelle ad hoc, elle se retourne d’abord contre sa fin, puis menace de destruction le corps social tout entier. Ivan Illich, La convivialité, in Œuvres complètes T.1, p. 454.
[4] Voir Fritz Schumacher, Ivan Illich ou André Gorz, parmi d’autres.
[5] Voir Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin, Héritage et fermeture, Paris, Divergences, 2021 ; Alexandre Monnin, Politiser le renoncement, Paris, Divergences, 2023.
RESSOURCES, 25-26 MARS 2025, ENSAP LILLE
Dès lors que la première ressource de l’architecture comprise comme transformation est le patrimoine lui-même (au sens défini plus haut), l’architecture se doit d’opérer un recentrement sur les ressources à disposition, tant celles dont on hérite que celles qu’on mobilise pour leur transformation. Nous nous interrogerons donc durant ces journées d’étude sur trois thèmes liés aux ressources : leur nature et leur mise en œuvre (1. Ressources et techniques) ; leur durabilité (2. Longue durée) ; leur usage (3. Suffisance).
- Ressources et techniques
L’interrogation portera sur les choix matériels et techniques spécifiques qu’induit la perspective transformatrice :
– l’analyse critique de l’usage des matériaux et des techniques qui les mobilisent, afin d’associer à la connaissance de leur mise en œuvre et de leurs performances une conscience plus aiguë de leur impact environnemental (filières, modes de production, « paysages réciproques »…),
– la relation du singulier et du typique, chaque situation de transformation, singulière par nature, étant en même temps typique d’une époque, d’une culture et d’une tradition dont il importe de connaître les récurrences constructives et typologiques qui les caractérisent,
– l’hybridité technique, puisque la transformation suppose l’emploi de systèmes constructifs hétérogènes dont le comportement statique, non connu par avance, exige de repenser la construction ainsi que son appareil normatif,
– les techniques de l’expertise avant-projet, pour développer la capacité de diagnostic quant à la transformabilité constructive et programmatique des édifices ou situations rencontrés.
– enfin, une interrogation plus large pourra concerner d’un côté l’analyse critique des structures qui administrent (politique), régulent (normes), financent (économie) et transmettent (pédagogie) le modèle extractiviste, productiviste et consumériste actuel, de l’autre les moyens de faire évoluer ledit modèle et les initiatives qui déjà s’y consacrent.
- Longue durée
Nous nous interrogerons dans cette session sur la capacité des ressources et des systèmes techniques qui les mobilisent à s’installer dans la longue durée :
– l’impact, sur les écosystèmes et les cycles du système Terre, des systèmes techniques issus de la révolution industrielle qui conditionnent l’exercice actuel de l’architecture, généralement basés sur des ressources matérielles et énergétiques dont les stocks paraissaient alors illimités,
– l’analyse critique des externalités induites par leur usage : épuisement desdits stocks, coûts et nuisances liés à leur exploitation, ainsi qu’à la transformation et à l’acheminement des matériaux,
– l’exploration, a contrario, des matériaux et des procédés de fabrication, de mise en œuvre et de fonctionnement susceptibles de perdurer sans épuiser les ressources qui leur sont nécessaires,
– l’exploration corollaire d’alternatives matérielles et techniques : technologies dites « appropriées » ou non-standard qui mobilisent les chaînes opératoires courtes, les circuits localisés, l’ancrage dans une culture et, plus généralement, la possibilité d’une re-territorialisation de et par l’architecture.
– le développement des techniques du soin, appuyées sur la formation d’une culture du vieillissement, de la maintenance et de la réparabilité.
- Suffisance
Pour une économie de suffisance (sufficiency) – qui s’oppose à l’efficience (efficiency) – la notion de bien-être ne repose pas sur l’accumulation des marchandises. Il s’agit donc de se dégager de l’emprise auto-accélératrice de la productivité, et pour cela de questionner les normes de confort, le modèle consumériste, et plus largement le principe de l’abondance. Dans une telle perspective, le fonctionnement des secteurs d’activité et la tâche des institutions se trouvent inversés : plutôt que d’insister sur le manque afin de promouvoir des produits toujours plus nombreux et plus performants, mais plus vite remplaçables et toujours moins réparables, il s’agit de rechercher un accord sur le niveau de biens qu’une majorité, au sein d’une population donnée, est susceptible de considérer comme suffisant[1]. L’architecture étant bien sûr concernée au premier chef, nous nous interrogerons dans cette session sur les conditions d’un tel accord (consommation énergétique et matérielle, normes d’usage et de confort), sur les moyens d’y parvenir (développement de « communs », organisation alternative de la production architecturale, mais aussi renoncement volontaire[2] à certaines ressources ou pratiques), ainsi que sur les manières d’en développer la didactique au sein du monde académique et de la société civile.
[1] Voir Fritz Schumacher, Ivan Illich ou André Gorz, parmi d’autres.
[2] Voir Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monnin, Héritage et fermeture, Paris, Divergences, 2021 ; Alexandre Monnin, Politiser le renoncement, Paris, Divergences, 2023.
